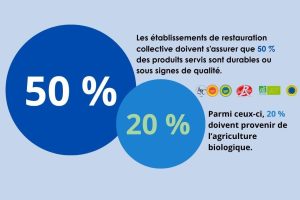RSE : Tout savoir sur la démarche RSE et les obligations des entreprises
La RSE, aussi appelée Responsabilité Sociétale des Entreprises, désigne l’intégration volontaire des préoccupations sociales, éthiques et environnementales dans la gestion et les activités économiques de l’entreprise. Avec la croissance des enjeux de développement durable, la RSE s’impose comme un moyen de transformation, de compétitivité et d’attractivité crucial des entreprises.
Mettre en place et structurer une politique RSE efficace et performante peut être un réel défi, car cela exige non seulement des ressources suffisantes, une implication concrète de l’ensemble de l’entreprise et un suivi des actions mises en place.
Comment faire de la Responsabilité Sociale des Entreprises un moteur de croissance efficace ? ETERNITY Systems vous explique tout sur les différentes dimensions de RSE – définition, bonnes pratiques, normes de références – et comment intégrer la RSE dans une stratégie durable et performante.

La RSE en résumé
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est une démarche volontaire qui vise à intégrer des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans le fonctionnement et la stratégie des entreprises. Elle repose sur trois piliers fondamentaux :
- Le social, qui englobe la qualité de vie au travail et l’inclusion,
- L’environnement, qui vise à réduire l’impact écologique des activités, et
- L’économie, qui favorise un développement durable et éthique.
Aujourd’hui, la RSE est un véritable levier de compétitivité et de différenciation, permettant aux entreprises d’anticiper les évolutions du marché et de répondre aux attentes croissantes des consommateurs, des employés et des investisseurs.
Mettre en place une politique RSE efficace passe par une approche structurée :
- Faire un diagnostic des enjeux,
- Définir des objectifs mesurables,
- Déployer des actions RSE concrètes et
- Effectuer un suivi des performances via un reporting et un rapport RSE.
L’intégration de certifications et de labels RSE sont là pour renforcer la crédibilité des engagements et faciliter l’accès à de nouvelles opportunités économiques. Chez Eternity Systems, nous avons fait de la RSE un moteur de transformation, structurant nos pratiques pour concilier performance, responsabilité et innovation.
Qu’est-ce que la RSE ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est définie par la Commission européenne comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». La RSE désigne ainsi la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, en intégrant une dimension sociale et environnementale dans leurs préoccupations économiques et dans leurs relations avec les parties prenantes.
Pour l’entreprise volontaire, il s’agit d’intégrer à son fonctionnement économique et à ses stratégies des pratiques responsables et durables pour impacter positivement la société et préserver l’environnement et ses ressources, tout en restant viable.
En France, l’adoption et la prise en compte de la RSE au sein de la politique des entreprises est en nette progression. En effet, selon une étude de l’institut de sondage et de conseil en marketing Kantar, publiée en 2024, 78 % des entreprises interrogées disposent d’une équipe dédiée à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, et 76 % ont alloué un budget spécifique à cette démarche, contre 68 % en 2022.
Les entreprises qui intègrent une démarche RSE au sein de leurs stratégies ou de leurs politiques doivent démontrer leur capacité à adopter des pratiques responsables en matière de gestion des ressources, de conditions de travail et de pratiques commerciales éthiques. Ces actions sont l’opportunité d’accroître la confiance des consommateurs et des investisseurs, tout en anticipant les futures exigences du marché.
Quelle est la différence entre RSE et ESS ?
La différence entre RSE et ESS est que la RSE transforme le fonctionnement des entreprises classiques, tandis que l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) repose de base sur un modèle économique solidaire, d’utilité sociale.
La RSE s’applique à toutes les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, et repose sur une démarche volontaire d’intégration des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans les activités de l’entreprise. L’ESS, en revanche, regroupe des organisations dont l’objectif premier est la solidarité et l’utilité sociale (coopératives, associations, mutuelles).
Quelle est la différence entre RSE et ESG ?
La RSE est une approche de gestion qui vise à intégrer des engagements de développement durables dans leur stratégie et leur fonctionnement, tandis que l’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) est un outil d’analyse externe, utilisés principalement par les investisseurs, les analystes financiers et les régulateurs pour mesurer la performance extra-financière des entreprises.
L’ESG est donc un ensemble de critères qui permettent d’évaluer dans quelle mesure une entreprise prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. La RSE et l’ESG sont souvent considérées comme complémentaires.

Quels sont les trois grands piliers de la RSE ?
La RSE repose sur 3 piliers :
- Le pilier sociétal (avoir un impact positif sur la société),
- Le pilier économique (être économiquement viable),
- Le pilier environnemental (être plus respectueux de l’environnement).
Chaque pilier de la Responsabilité Sociale des Entreprises structure l’engagement des entreprises envers une croissance responsable et durable, pour un impact positif sur la société tout en restant viable économiquement.
Le pilier social : investir dans l’humain
L’engagement et la responsabilité sociale sont le premier socle de la RSE. Il concerne des aspects comme la qualité de vie au travail, la diversité, l’inclusion, la formation ou encore la protection des droits des salariés.
Une entreprise socialement responsable investit dans ce qui est humain et veille ainsi à offrir des conditions de travail optimales pour favoriser l’épanouissement des employés et fidéliser les talents. Il est démontré que des salariés motivés et engagés augmentent la productivité, réduisent l’absentéisme et renforcent l’image de marque de l’entreprise.
Les salariés qui se sentent bien dans une entreprise auront donc envie de s’investir, de promouvoir les valeurs de l’entreprise et de rester sur du long terme. Ce climat de travail positif se traduit ensuite par des équipes de travail plus stables, plus soudées et donc plus performantes.
Le pilier environnemental : le cœur de la RSE
Le pilier environnemental de la Responsabilité Sociale des Entreprises concerne la gestion responsable des ressources naturelles et la réduction des impacts négatifs des activités économiques. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’a aussi été établie la Loi AGEC, qui impose de plus en plus aux entreprises de faire des efforts en matière de déchets et de recyclage.
C’est pour cela qu’intégrer une stratégie écoresponsable est primordial, dans un contexte où les réglementations environnementales se durcissent et où les consommateurs privilégient des marques engagées. Cela passe par la réduction des émissions de CO₂, l’optimisation de la consommation énergétique, la gestion des déchets ou encore l’adoption d’une logistique durable.
L’intégration de ces pratiques environnementales de la RSE ne se limite pas à une contrainte réglementaire, elle représente surtout une opportunité stratégique pour anticiper les exigences du marché et capter une clientèle de plus en plus attentive aux engagements écologiques.
Le pilier économique : réussir à combiner rentabilité et durabilité
Ce pilier repose sur l’éthique des affaires, la transparence financière ou encore l’innovation durable. Cela signifie qu’une entreprise responsable ne doit pas se contenter pas de générer du profit, elle doit veiller aussi à sa pérennité et à sa compétitivité en intégrant des critères sociaux et environnementaux dans sa stratégie. Ces critères peuvent être une politique de télétravail flexible, une politique de recrutement inclusive, la réduction de son empreinte carbone en optimisant la gestion des déchets, etc.
Il s’agit d’intégrer les attentes des consommateurs et des investisseurs en matière de responsabilité sociétale pour renforcer la compétitivité et attirer des investisseurs pour fidéliser les clients. La transparence et l’engagement sont devenus des facteurs de différenciation, et les entreprises qui prennent ce virage stratégique augmentent leur compétitivité et créent une relation de confiance avec les clients et les partenaires.

Pourquoi adopter une démarche RSE en entreprise ?
Si la RSE est une démarche volontariste, elle est surtout devenue un moyen de façonner la réputation d’une entreprise, de redéfinir la relation entreprise-salarié, et aussi d’ouvrir de nouvelles opportunités économiques. Les bénéfices de la Responsabilité Sociétale des Entreprises sont multiples et vont bien au-delà du simple respect d’obligations légales.
On peut retenir 3 bénéfices principaux de la RSE :
- Levier puissant pour la réputation et l’image de l’entreprise,
- Avantage pour attirer et fidélisation les talents au sein de l’entreprise,
- Moteur de croissance et de compétitivité.
Un levier puissant pour la réputation et l’image de marque de l’entreprise
En France, selon une étude sur la responsabilité sociale et environnementale des grands groupes vue par les Français, réalisée par l’institut GoudLink, près de 9 consommateurs sur 10 attendent des entreprises qu’elles agissent de manière responsable et répondent aux enjeux sociaux et environnementaux.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, une entreprise engagée en RSE inspire confiance. Les consommateurs, mieux informés et plus exigeants, attendent désormais des marques qu’elles adoptent des pratiques transparentes et responsables. Ce ne sont plus seulement des acheteurs passifs, mais, avec la société civile, sont désormais des parties prenantes actives.
Un avantage pour attirer et fidéliser les talents au sein de l’entreprise
Dans un contexte où le marché du travail est ultra-concurrentiel, la capacité d’une entreprise à attirer et retenir les meilleurs talents ne dépend plus uniquement du salaire ou des avantages financiers. Les employés, en particulier les jeunes générations, recherchent avant tout du sens dans leur travail et souhaitent évoluer dans une organisation qui partage leurs valeurs.
Selon le Baromètre de perception de la RSE en entreprise du MEDEF, 40 % des salariés estiment que la qualité de vie au travail est une priorité pour leur entreprise. Par ailleurs, cette étude indique que 79 % des salariés envisagent de rester dans leur entreprise dans les trois prochaines années lorsque celle-ci est dotée d’une fonction ou d’un service RSE (contre 68 % sans service RSE).
Cette corrélation suggère que les initiatives de Responsabilité Sociale des Entreprises, incluant la promotion de la qualité de vie au travail, contribuent à la fidélisation des employés.
Les entreprises qui prennent en compte le bien-être de leurs employés, qui favorisent la diversité et qui s’engagent dans des causes sociétales, créent une culture d’entreprise plus attractive et plus pérenne. Résultat : des équipes plus engagées, plus productives et prêtes à s’investir sur le long terme.
Un moteur de croissance et de compétitivité
La RSE est un levier économique puissant, car elle permet d’optimiser les coûts (économie d’énergie, réduction des déchets, meilleure gestion des ressources), d’accéder à de nouveaux marchés et de séduire des investisseurs qui sont de plus en plus attentifs aux critères RSE.
En effet, les investisseurs ne se contentent plus d’un rendement financier immédiat, ils exigent désormais des entreprises qu’elles démontrent leur capacité à créer une valeur durable en intégrant la RSE dans leur démarche de développement durable.
Les entreprises qui adoptent une politique RSE structurée ne se contentent pas d’améliorer leur image auprès des parties prenantes : elles attirent plus facilement des financements, accèdent à des taux préférentiels et limitent leur exposition aux risques juridiques.
Chez ETERNITY Systems, nous avons compris qu’une partie de la croissance repose sur une gouvernance transparente, une gestion responsable des ressources et une politique sociale engagée. En intégrant la Responsabilité Sociale des Entreprises au cœur de notre stratégie, nous anticipons les attentes des investisseurs et des parties prenantes, tout en consolidant notre position sur le marché. Adopter une démarche RSE ambitieuse, c’est non seulement répondre aux enjeux actuels, mais aussi construire un avantage compétitif durable pour l’avenir.

ETERNITY Systems et les bonnes pratiques RSE
Chez ETERNITY Systems, spécialiste du lavage industriel d’emballages et de contenants réutilisables, l’entreprise incarne pleinement les principes de l’économie circulaire. Forte de cette identité, elle a engagé une démarche RSE structurée autour de trois piliers clairs :
Cette vision s’appuie sur une conviction profonde : repenser les industries à travers le prisme du réemploi est non seulement possible, mais nécessaire.
« Les salariés sont impliqués au quotidien dans la démarche RSE notamment dans la gestion de l’eau lors de l’application de notre politique de gestion de l’eau ou encore lorsqu’ils sont formés sur des thématiques climat telle que notre nouvelle formation Climatelier ».
La chargée de Développement RH et RSE, rattachée au DRH Groupe et impliquée au sein du comité de direction affirme qu’en donnant aux individus les moyens d’agir, en maîtrisant son impact environnemental et en renforçant ses ancrages locaux, ETERNITY Systems fait de ses engagements un levier de performance durable.
Concrètement, les équipes d’ETERNITY Systems traduisent cette ambition en actions tangibles :
- Création de zones sécurisées pour éviter les co-activités entre piétons et véhicules industriels
- Implication dans des initiatives locales telles que Empower HER au Canada ou Run for Planet en France
- Optimisation continue de la gestion des ressources – eau, électricité, gaz – avec une attention croissante portée au tri, à la valorisation et au recyclage des déchets.
L’ensemble de ces efforts est mesuré par des indicateurs de performance précis, rassemblés dans un rapport RSE public, accessible à tous. Si l’entreprise ne dispose pas encore d’une certification officielle, une analyse est en cours, illustrant une volonté claire : faire évoluer ses engagements vers un niveau d’excellence reconnu.
Quel est le cadre réglementaire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ?
Le concept de la RSE s’inscrit dans un cadre réglementaire structuré et encadré par des normes internationales, des certifications reconnues et des obligations légales qui garantissent la crédibilité, la sécurité et l’efficacité des démarches entreprises. Ces référentiels en vigueur permettent aux entreprises d’adopter des politiques RSE conformes pour répondre au mieux aux parties prenantes.
Les normes RSE
Les normes RSE, normes ISO 14001, 9001, 45000, 50001 et 20400 et 26000, établissent des lignes directrices claires pour aider les entreprises à intégrer le développement durable dans leur stratégie. La norme RSE la plus connue est l’ISO RSE 26000, un guide méthodologique destiné à accompagner les entreprises dans l’élaboration de leur démarche RSE. Elle couvre 7 domaines :

L’objectif de cette norme ISO 26000 est d’orienter les entreprises dans l’intégration des principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, tout en leur laissant la flexibilité nécessaire pour adapter leur démarche à leur secteur d’activité, leur taille et leurs enjeux spécifiques.
Il faut noter que l’ISO 26000 n’est ni contraignante ni obligatoire. Cependant, elle est largement adoptée par les entreprises, car elle offre un cadre structurant et reconnu au niveau international. Cela permet aux entreprises de formaliser leur engagement RSE, d’aligner leurs pratiques avec les attentes des parties prenantes et de renforcer leur crédibilité auprès des investisseurs, clients et partenaires.
De plus, les normes RSE s’intègrent souvent aux démarches QHSE, qui visent à améliorer simultanément la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement au sein de l’entreprise. C’est aussi cette approche globale qui permet une meilleure gestion des risques et une optimisation des performances sociales et environnementales de l’entreprise.
Les certifications et labels RSE
Au-delà des normes, certaines entreprises choisissent d’obtenir une certification RSE, qui atteste officiellement de leur engagement RSE. Ces certifications sont délivrées par des organismes indépendants et permettent d’évaluer l’impact des politiques mises en place :
- Label Engagé RSE (AFNOR) : basé sur l’ISO 26000, ce label évalue la maturité des entreprises en matière de responsabilité sociétale et leur capacité à s’améliorer en continu ;
- B Corp : label de renommée internationale exigeant, attribué aux entreprises qui répondent à des standards élevés en matière d’impact et de performance sociale, environnementale et de transparence ;
- Ecovadis : c’est une plateforme d’évaluation des pratiques RSE des entreprises, utilisée notamment par les grands groupes pour sélectionner leurs fournisseurs responsables ;
- Label Lucie 26000 : il s’agit de la première certification française RSE alignée sur l’ISO 26000, attribuée aux entreprises ayant une approche structurée et cohérente du développement durable.
La labellisation RSE permet de renforcer la crédibilité de l’entreprise auprès de ses clients, ses partenaires et ses investisseurs.
Le cadre réglementaire de la RSE
Même si la Responsabilité Sociale des Entreprises repose sur une démarche volontariste et qu’il n’existe aucune loi contraignante en matière de durabilité, la réglementation évolue pour imposer des obligations RSE aux entreprises, notamment en matière de transparence et de reporting des activités tant au niveau société qu’environnemental.
- Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) : en 2024, cette nouvelle directive européenne, remplaçant la NFRD (Non-Financial Reporting Directive), a élargi le périmètre des entreprises concernées par l’obligation de reporting extra-financier. Désormais, les entreprises de plus de 250 salariés et réalisant plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, devront publier des données détaillées sur leur impact environnemental, social et de gouvernance.
- Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) : en France, les entreprises cotées et certaines grandes entreprises doivent publier un rapport détaillant leurs engagements et leurs actions en matière de développement durable.
- Loi PACTE : promulguée en 2019, cette loi consolide la RSE des entreprises. En effet, depuis cette loi, l’article 1833 du Code civil a été modifié afin que l’objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux. D’autre part, l’article 1835 du Code civil a été modifié afin de permettre aux entreprises d’intégrer, si elles le souhaitent, une raison d’être directement dans leurs statuts. Enfin, le statut d’entreprise à mission a été créé, permettant aux entreprises de formaliser des objectifs sociaux et environnementaux dans leurs statuts, en complément de leur but lucratif.

Comment mettre en place une stratégie RSE efficace en entreprise ?
Mettre en place une stratégie RSE repose sur une analyse rigoureuse, une intégration progressive dans la gouvernance et une communication transparente. Pour réussir ces différentes étapes, et faire de la Responsabilité Sociale des Entreprises un véritable levier de performance, chaque entreprise doit suivre une méthodologie précise et adaptée :
- Réaliser un diagnostic RSE,
- Définir les objectifs RSE de l’entreprise,
- Construire un plan d’action,
- Communiquer avec les parties prenantes à la RSE.
Le diagnostic RSE pour identifier les enjeux importants
Un diagnostic RSE permet d’évaluer l’impact social, environnemental et économique de l’entreprise. C’est grâce à cette analyse que l’entreprise peut identifier les forces, les faiblesses et les axes d’amélioration en matière de développement durable. Cette évaluation repose sur plusieurs choses :
- Un audit RSE, qui peut être mené en interne ou par un expert externe, pour analyser la performance de l’entreprise sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance,
- Une cartographie des parties prenantes, afin de comprendre les attentes des clients, collaborateurs, fournisseurs et investisseurs,
- Une étude des enjeux RSE propres au secteur d’activité de l’entreprise, afin d’aligner la stratégie sur les exigences du marché et les réglementations en vigueur.
Le bilan RSE obtenu à l’issue du diagnostic servira de base pour construire un plan d’action pertinent et mesurable.
Définir les objectifs RSE de l’entreprise
Fixer des objectifs RSE clairs et cohérents permet de structurer la démarche et de garantir son efficacité. Les objectifs doivent être alignés avec la stratégie globale de l’entreprise et intégrés dans le quotidien des équipes pour assurer un impact durable. Ainsi, les objectifs RSE doivent être :
- Spécifiques : en lien avec les priorités stratégiques de l’entreprise.
- Mesurables : avec des indicateurs de suivi définis.
- Atteignables : réalistes et adaptés aux capacités de l’organisation.
- Alignés sur les normes et référentiels : comme l’ISO 26000, les ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’ONU, ou les exigences des investisseurs ESG.
Une gouvernance RSE structurée est primordiale pour garantir la cohérence et l’efficacité des objectifs mis en place. Cela implique la désignation d’un responsable RSE ou d’une équipe dédiée, chargée de piloter la stratégie et de coordonner les initiatives avec l’ensemble des services de l’entreprise.
Construire un plan d’action et lancer des projets RSE concrets
Une fois les objectifs RSE définis, il faut mettre en place des actions RSE concrètes. Le projet RSE doit être déployé de manière progressive et adaptée aux ressources disponibles. Il peut inclure des actions telles que :
- L’optimisation des processus internes pour réduire l’impact environnemental (économie d’énergie, gestion des déchets, logistique durable).
- Le développement d’une politique sociale forte (égalité hommes/femmes, inclusion, bien-être au travail).
- La mise en place d’une plateforme RSE pour centraliser les engagements et les initiatives de l’entreprise, faciliter le suivi et le partage des résultats.
- L’intégration de critères RSE dans les achats et la relation fournisseurs pour favoriser une chaîne d’approvisionnement responsable.
Chaque projet RSE doit être accompagné d’un calendrier, de ressources allouées et d’un suivi rigoureux des résultats.
Communiquer avec les parties prenantes à la RSE
Une communication RSE, en interne comme en externe, est essentielle pour donner de la crédibilité aux engagements de l’entreprise. C’est-à-dire qu’il faut non seulement informer, mais aussi mobiliser les collaborateurs, les clients, les investisseurs et les partenaires.
Pour cela, il faut que l’entreprise ait une communication interne (réseaux sociaux, intranet, etc.) forte pour sensibiliser et impliquer les salariés. Mais aussi un dialogue ouvert avec les parties prenantes, via des consultations et des échanges réguliers.

Comment mesurer et optimiser sa stratégie RSE en entreprise ?
Pour qu’elle soit pertinente, une démarche RSE doit être basée sur des données tangibles et un suivi régulier. Il faut donc au préalable définir des indicateurs RSE précis qui vont couvrir les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance.
Ces données sont ensuite intégrées dans un document écrit qu’on appelle rapport RSE. Le rapport RSE va permettre de mesurer les progrès accomplis, d’identifier les axes d’amélioration et de valoriser les résultats obtenus sur l’année.
Ce rapport RSE correspond généralement un reporting annuel, partagé en interne comme en externe. Cela permet de valoriser les efforts de l’entreprise au sein même des employés et auprès de la clientèle et des partenaires, afin de fédérer l’ensemble des parties prenantes autour des avancées en matière de développement durable.
D’autre part, une stratégie RSE ne fonctionne que si elle est comprise et portée par l’ensemble des collaborateurs. Pour cela, investir dans formations RSE, que ce soit sur les enjeux environnementaux, l’économie circulaire ou encore les achats responsables, peut s’avérer très utile pour les différents niveaux de l’entreprise :
- Pour les dirigeants et managers : afin d’intégrer la RSE dans la prise de décision stratégique.
- Pour les collaborateurs : afin de les impliquer et de leur donner des outils concrets pour appliquer les engagements RSE au quotidien.
Une entreprise qui mise sur la formation RSE assure non seulement une meilleure mise en œuvre de sa politique, mais favorise également l’innovation en interne, en incitant les équipes à proposer de nouvelles solutions durables.
Optimiser sa stratégie de Responsabilité Sociale des Entreprises demande souvent une expertise pointue pour aller plus loin que les actions de base. C’est pourquoi de nombreuses entreprises font appel à un conseil RSE externe, capable d’apporter un regard objectif et d’accompagner l’optimisation de la démarche.
L’avenir de l’industrie passe par des modèles responsables, en intégrant la RSE au cœur de sa stratégie. C’est un levier essentiel pour conjuguer performance économique, impact environnemental et engagement social. Structurée et portée à tous les niveaux de l’entreprise, elle permet de construire un modèle durable, aligné avec les attentes des parties prenantes et les défis de demain